1. L’article L. 211-1 du Code des assurances fait obligation à « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué » de souscrire une assurance de responsabilité civile automobile. Celle-ci entre en conséquence dans la catégorie des assurances obligatoires.

2. Afin que l’objectif, poursuivi par le législateur, d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation soit atteint, la loi ne se borne pas à imposer la souscription de l’assurance, mais fixe également impérativement l’étendue des garanties qui doivent être octroyées. L’article L. 211-5 du Code des assurances énonce en effet qu’un « décret en Conseil d’Etat […] fixe notamment l’étendue de la garantie que doit comporter le contrat d’assurance » et précise que « tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation [d’assurance RC auto] est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d’Etat ». Le décret (n° n°86-21) du 7 janvier 1986, dont les dispositions figurent à l’article R. 211-5 du Code des assurances énonce ainsi que « l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits ». Le montant des garanties est pareillement strictement réglementé. L’article R. 211-7 du Code des assurances (dans sa rédaction issue d’un décret n°2007-1118 du 21 juillet 2007) enjoint en effet à l’assureur de fournir une garantie illimitée s’agissant des dommages corporels et lui interdit de stipuler un plafond de garantie inférieur à 1 million d’euros (par sinistre et quel que soit le nombre de victimes) s’agissant des dommages matériels.
3. Afin que la garantie ainsi déterminée ne soit pas vidée de sa substance, un décret (n°93-581) du 26 mars 1993 a énuméré, limitativement, les exclusions de garantie que l’assureur de responsabilité civile auto est autorisé à stipuler dans la police. L’article R. 211-10 du Code des assurances (dans sa rédaction issue de ce décret) prévoit ainsi que « le contrat d’assurance peut […] comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ». L’article R. 211-11 du Code des assurances (dans sa rédaction issue du même décret) complète la liste des exclusions permises en énonçant que « sont valables […] les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré :
1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
[…2° abrogé]
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
4° Du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics ».
4. En outre, par dérogation au droit commun des assurances de responsabilité, l’article R. 211- 13 du Code des assurances interdit d’opposer les exclusions que l’on vient d’évoquer aux tiers lésés. Il en résulte que l’assureur est toujours tenu d’indemniser ces derniers et ne peut, lorsque le sinistre est survenu dans des circonstances exclusives de garantie, que se retourner contre son assuré pour lui réclamer remboursement des indemnités versées.
5. Il en va de même lorsque la police est atteinte d’une cause de nullité. Là encore, par dérogation au droit commun, il fait interdiction à l’assureur d’opposer cette nullité au tiers victime (C. assur., art. L. 211-7-1), de sorte qu’il doit indemniser celui-ci avant d’exercer un recours contre son assuré.
6. La Cour de cassation a longtemps considéré que ce principe d’inopposabilité des exceptions n’avait pas un caractère absolu et pouvait en conséquence être écarté au détriment de certaines victimes, précisément celles qui, ayant la qualité de souscriptrice de la police, s’étaient rendues coupables de certaines fautes. C’est cette jurisprudence qu’abandonne la Haute Cour dans une série d’arrêts récents, lesquels viennent étendre au souscripteur victime, en toutes circonstances, le bénéfice de la règle d’inopposabilité tant des exclusions de garantie (II) que de la nullité de la police (II).

I. – Extension du cercle des bénéficiaires de l’inopposabilité des exclusions
7. L’article R. 211-10, 1°, du Code des assurances permet à l’assureur de responsabilité civile automobile de stipuler une exclusion de garantie lorsque le conducteur du véhicule assuré était dépourvu du permis de conduire. L’article R. 211-13 du même Code interdit cependant à l’assureur d’opposer cette exclusion « aux victimes ou à leurs ayants droit ».
8. Cette inopposabilité doit-elle être maintenue au profit du souscripteur de la police d’assurance, blessé dans l’accident, dès lors qu’il a sciemment confié le volant à une personne qui n’était pas titulaire du permis ?
9. La Cour de cassation a longtemps répondu par la négative, estimant que l’assureur devait être libéré de son obligation de garantie en pareille circonstances (Crim., 8 novembre 1990, pourvoi n° 88-86.418 : Bull. crim., n° 373. – Cass. 2e civ., 20 novembre 1996, n° 94-20.884, Bull. civ. II, n° 258. – Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 98-19.023 : Bull. civ. I, n° 159. – Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 12-86070. – Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 12-86070).

10. Par un arrêt du 19 novembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue mettre un terme à cette jurisprudence plus que trentenaire en décidant que sont « inopposables à l’assuré victime, qui n’était pas conducteur du véhicule assuré, les clauses prévoyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule », y compris « lorsque la victime s’est elle-même mise dans la situation exclusive de garantie » (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85009, FS–B : JurisData n° 2024-020698 ; BJDA janv. 2025, n° 96, comm. 12, A. Trescases ; Resp. civ. et assur. janv. 2025, comm. 22, V. Tournaire ; LEDA janv. 2025, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel ; RGDA déc. 2024, p. 18, note J. Landel).
11. La solution est fondée sur l’interprétation qui est faite, par la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 13 de la directive 2009/103 du 16 septembre 2009 « concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs ». L’article 13 énonce que doit être « réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre, toute disposition légale ou clause contractuelle contenu dans la police d’assurance [automobile obligatoire] qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicule par […] des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné […] ». Or la CJUE a estimé « que le fait qu’une personne était assurée pour conduire le véhicule ayant causé l’accident ne permet pas de la priver de la qualité de tiers lésé au sens de l’article 13 précité, dès lors qu’elle était passagère, et non conductrice, de ce véhicule » (CJUE, 30 juin 2005, Katja Candolin et a. c/ Vahinkovakuutusosakeyhtiö, C-537/03 ; CJUE, 1er décembre 2011, Churchill Insurance Company Limited c/ Benjamin Wilkinson, C-442/10).
Le droit communautaire incluant le souscripteur de la police, dès lors qu’il n’est pas conducteur, dans la catégorie « des tiers lésés », sans réserver le cas où il se serait placé en connaissance de cause dans une situation exclusive de garantie, il doit bénéficier de la règle d’inopposabilité des exclusions et obtenir indemnisation de ses préjudices.
II. – Extension du cercle des bénéficiaires de l’inopposabilité des nullités
12. Depuis une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16, Fidelidade Companhia de Seguros : Resp. civ. et assur. déc. 2017, étude 13, H. Groutel ; RGDA 2017/11, p. 552, note J. Landel ; RDC janv. 2018/1, p. 73, obs. F. Leduc), la nullité du contrat d’assurance automobile (fondée, notamment, sur une fausse déclaration intentionnelle du risque à l’assureur) est inopposable « aux tiers victimes ». La solution, d’origine jurisprudentielle, a été entérinée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, laquelle a introduit dans le Code des assurances un article L. 211-7-1 qui énonce que « la nullité d’un contrat d’assurance [RC automobile] n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ».
13. L’interdiction faite à l’assureur d’opposer la nullité doit elle-bénéficier au souscripteur, victime de l’accident, par ricochet ou en qualité de passager, lorsqu’il est l’auteur de la fausse déclaration source de nullité du contrat ?
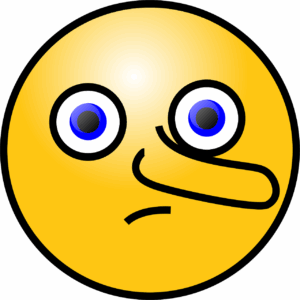
14. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ainsi que la Cour de cassation ont fermement répondu par l’affirmative. Saisie pour avis, à l’occasion d’un litige opposant un assureur au souscripteur du contrat qui avait délibérément menti sur l’identité du conducteur habituel et réclamait néanmoins indemnisation du préjudice qu’il avait subi en qualité de passager, la CJUE a estimé que « l’article 3, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, sauf si la juridiction de renvoi constate l’existence d’un abus de droit, à une réglementation nationale qui permet d’opposer au passager d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui est victime de cet accident, lorsque celui-ci est également le preneur d’assurance, la nullité du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile résultant d’une fausse déclaration de ce preneur d’assurance faite lors de la conclusion de ce contrat ». La CJUE a en outre précisé que l’assureur ne pouvait pas être autorisé à « obtenir le remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées à ce passager en exécution du contrat d’assurance au moyen d’un recours introduit contre ce dernier […], dès lors qu’un tel remboursement conduirait à priver de tout effet utile les dispositions de cette directive, en limitant de manière disproportionnée le droit de la victime à obtenir une indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs » (CJUE, 19 sept. 2024, n° C-236/23 : BJDA nov. 2024, n° 95, comm. 16, A. Trecases ; Resp. civ. et assur. nov. 2024, comm. 254, V. Tournaire ; BJDA mars 2025, comm. 13, L. Perdrix ; LEDA nov. 2024, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel). Saisie pour avis par la Chambre criminelle, la 2ème Chambre civile s’est conformée à la jurisprudence communautaire et a pareillement estimé que « la nullité du contrat d’assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l’identité du conducteur habituel, doit être déclarée inopposable à la victime, y compris quand elle est à la fois le passager du véhicule ayant causé l’accident et le souscripteur de l’assurance, auteur de cette fausse déclaration, sauf si la juridiction constate l’existence d’un abus de droit commis par cette victime » (Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 22-70015 : LEDA févr. 2025, p. 3, obs. C. Béguin-Faynel).
15. La même solution a été retenu dans l’hypothèse, voisine, où le souscripteur, auteur de la fausse déclaration à l’origine de la nullité du contrat, est victime par ricochet de l’accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué. La Cour de cassation a en effet estimé, au regard de la position (ci-dessus exposée) de la CJUE que « la nullité édictée par l’article L.113-8 du code des assurances n’est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d’assurance, à l’origine de la fausse déclaration, sauf si elle a commis un abus de droit » (Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, nos 23-15983 et 23-16795, FS–BR : JurisData n° 2025-000742 ; Resp. civ. et assur. mars 2025, étude 3, Ph. Brun et V. Tournaire ; BJDA mars 2025, comm. 13, L. Perdrix ; LEDA mars 2025, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel). En l’espèce, l’auteur de la fausse déclaration intentionnelle du risque réclamait son indemnisation – à l’assureur RC automobile – du préjudice par ricochet par lui subi du fait des dommages corporels causés à ses enfants mineurs passagers du véhicule assuré.
16. Ces solutions sont très (peut-être trop) favorables au souscripteur auteur de la fraude, dont la mauvaise foi n’est pas sanctionnée, puisqu’il est intégralement indemnisé sans recours possible contre lui. La CJUE, comme la Cour de cassation, réserve, certes, l’hypothèse d’un « abus de droit », qui ferait perdre au souscripteur le bénéfice de l’inopposabilité de la nullité. Mais, la CJUE a précisé que « la preuve d’une pratique abusive nécessite [de relever] un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention », ce qui suppose que « [le preneur] ait effectué de fausses déclarations dans le but essentiel de se prévaloir lui-même des articles 3 et 13 de la directive 2009/103 et de contourner une disposition nationale relative aux conditions légales de nullité d’un contrat d’assurance » (pt 54). Etant donné cette définition très restrictive, l’existence d’un « abus » apparaît comme une hypothèse d’école. Pour retenir l’abus, il faudrait en effet relever chez le souscripteur-auteur de la fausse déclaration, une intention délibérée, dès la conclusion du contrat, de solliciter sa prise en charge comme victime malgré l’annulabilité du contrat. Or les mensonges du souscripteur sont dictés, dans la l’immense majorité des cas, sinon dans tous les cas, par une volonté de convaincre l’assureur d’accorder sa garantie à un moindre coût et non par une intention d’échapper aux conséquences de l’annulation du contrat pour le cas où il serait victime d’un accident impliquant le véhicule assuré.
Maud Asselain
