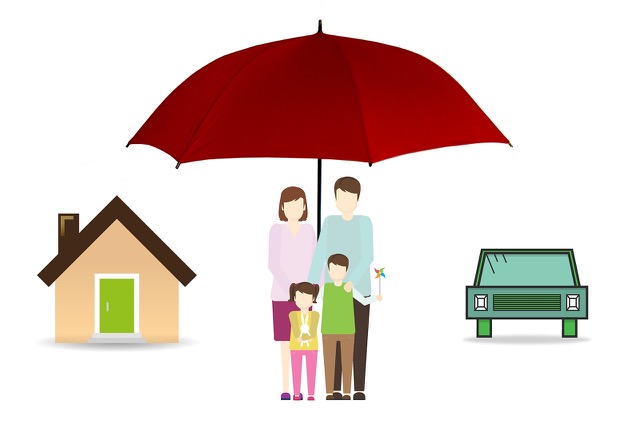Les nouveautés issues de la loi du 23 juin 2025
L’article 3 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, « visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » a modifié l’article L. 121-2 du Code des assurances afin de permettre à l’assureur, tenu de couvrir la responsabilité de son assuré du fait de ses enfants mineurs, d’exiger de celui-ci, sous réserve de sa défaillance parentale pénalement constatée, une participation à l’indemnisation de la victime du dommage.
« La délinquance des mineurs a explosé au cours des dernières décennies » ; parmi les causes majeures de cette « explosion », figurent « la fragilité de la cellule familiale et les carences éducatives graves », constate, chiffres à l’appui, le député F. Terlier (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_lois/l17b0628_rapport-fond#).
La loi n° 2025-568, adoptée le 23 juin 2025 (entrée en vigueur le 25 juin), « visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » a pour objectif, comme son nom l’indique, de remédier à ce phénomène.
L’article 1er de la loi a ainsi créé une nouvelle circonstance aggravante du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un mineur. Ce délit, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende est défini par l’article 227-17, alinéa 1, du Code pénal comme « le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur ». L’alinéa 2, nouveau, de ce même texte prévoit désormais que « lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Outre un alourdissement de la responsabilité pénale des parents gravement démissionnaires, la loi nouvelle vise également à une responsabilisation accrue de ces derniers sur le plan civil.
Pour ce faire, elle consacre, en premier lieu, la jurisprudence récente, laquelle a supprimé la condition de cohabitation de l’enfant avec le parent dont la responsabilité est recherchée. Alors que l’article 1242, alinéa 4, ancien, du Code civil subordonnait expressément l’engagement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur à la « cohabitation » de ce dernier avec eux, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet estimé, dans un arrêt en date du 28 juin 2024, que « les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » (Cass., ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 : JurisData n° 2024 -010199 ; Gaz. Pal. 3 sept. 2024, note J.-S. Borghetti ; JCP G 2024, 1390, note L. Vitale ; Resp. civ. et assur. 2024, comm. 190, J. Lagoutte). En d’autres termes, tant que le père et la mère sont titulaires de l’autorité parentale, ils sont civilement responsables de leur enfant mineur, peu important, à cet égard, que la résidence de l’enfant soit fixée chez l’un d’entre eux seulement (notamment en cas de divorce) ou que l’enfant, de facto, ne cohabite effectivement avec aucun d’entre eux (parce que, par exemple, il a été confié « à l’amiable » à ses grands-parents ou se trouve en pension à l’étranger). C’est cette solution, qui responsabilise les deux parents, que retient la loi du 23 juin 2025. L’article 1242, alinéa 4, dans sa nouvelle rédaction, énonce désormais que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ».
En second lieu, la loi de 2025 est venue ajouter deux alinéas à l’article L. 121-2 du Code des assurances. L’alinéa 1er de ce texte, qui demeure inchangé, contraint l’assureur de responsabilité civile à prendre en charge les « pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
De ce texte, d’ordre public, la jurisprudence a déduit que l’assureur qui couvre la responsabilité personnelle de son assuré est également tenu de garantir la responsabilité civile qu’il encourt du fait d’autrui et, notamment, du fait de ses enfants mineurs, y compris lorsque ceux-ci ont commis une faute intentionnelle ou dolosive (Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, n° 90-18.018 : JurisData n° 1993-003043 ; Bull. civ. 1993, I, n° 324 ; Resp. civ. et assur. 1994, comm. 151 et chron. 11, H. Groutel ; Bull. civ. 1993, I, n° 324. – Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 09-14.227 : JurisData n° 2011-013036 ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 303 ; RGDA 2011, p. 1104, note J. Bigot. – Cass. 1re civ., 15 juin 2000, n° 98-21502 : JurisData n° 2000-002516 ; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 311, H. Groutel). Le texte interdit en effet que les exclusions de garantie qui s’attachent « à la nature ou la gravité de la faute commise » soient opposées à l’assuré lorsque c’est sa responsabilité du fait d’autrui qui est recherchée (alors qu’elles lui sont évidemment opposables, dès lors qu’elles respectent les conditions de validité auxquelles le Code des assurances les soumet, lorsqu’il est l’auteur direct du dommage).

Le texte était conçu, à l’origine, comme une dérogation à l’interdiction de garantir les fautes intentionnelle et dolosive, dans la mesure où il autorisait le jeu de l’assurance dès lors que ce type de faute était commis, non par l’assuré lui-même, mais par une personne dont il devait répondre. Cette dérogation se justifiait par le fait que, tant pour l’assureur que pour l’assuré, le risque que l’enfant mineur (ou le préposé) de l’assuré commette une faute d’une telle gravité était aléatoire et en conséquence constituait un risque assurable qu’il était dans l’intérêt de l’assuré de voir garanti.
Cette justification demeure, mais doit être nuancée dans un contexte de hausse de la délinquance des mineurs, que les parlementaires s’accordent à imputer, au moins en partie, à des « carences éducatives graves » (F. Terlier, rapport préc.). Le risque qu’un enfant commette des fautes intentionnelles ou dolosives (constitutives, le cas échéant, d’infractions pénales) n’est certainement pas aussi aléatoire pour des parents gravement démissionnaires qui ont laissé le mineur livré à lui-même que pour des parents qui assument leurs obligations de surveillance et d’éducation. En outre, il peut sembler illégitime que les premiers bénéficient d’une couverture d’assurance aussi étendue que celle des seconds et qu’ils soient en conséquence à l’abri de toute sanction civile, alors que, par leur comportement défaillant, ils ont, sinon causé le dommage, du moins favorisé sa réalisation.
C’est pourquoi, à l’initiative du Sénat (V. Rapport Sénat F. Szpiner : https://www.senat.fr/rap/l24-463/l24-4636.html#toc43), la loi du 23 juin 2025 a modifié l’article L. 121-2 du Code des assurances. Ce texte comporte désormais un alinéa 2 qui interdit au parent coupable du délit visé à l’article 227-17 du Code pénal (précité) de se décharger intégralement des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile sur son assureur. Précisément, le texte prévoit que « lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l’un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros ».
Après indemnisation de la victime du dommage (causé par l’enfant mineur), l’assureur est désormais en droit d’exercer un recours contre son propre assuré (civilement responsable de son enfant), dès lors que celui-ci a été condamné pénalement en raison de sa défaillance parentale « pour des faits en lien avec la commission du dommage ».
Le texte manque malheureusement de précisons. Que sont les faits « en lien avec la commission du dommage » ? Faut-il que la condamnation de l’assuré coupable de s’être soustrait, « sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur » (C. pén., art. 227-17) soit simplement prononcée à l’occasion de la survenance du dommage causé par l’enfant mineur ou faudra-t-il, plus strictement, que cette condamnation soit motivée par une relation de cause à effet entre l’attitude de l’assuré et la faute dommageable de son enfant mineur ?
Pareillement, le droit pour l’assureur « d’exiger [du parent défaillant] le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros » laisse perplexe. Cela signifie-t-il que l’assureur peut exercer un recours contre son assuré dans la limite de 7 500 euros et être intégralement remboursé de l’indemnité qu’il a payée à la victime dès lors que l’indemnité en question n’excède pas cette somme ? Le texte évoquant une simple « participation » de l’assuré, il semble néanmoins contraindre l’assureur à conserver à sa charge une partie de l’indemnisation et ce, quel que soit le montant soit sinistre.
Quant au montant de cette participation, peut-il être déterminé librement par l’assureur (dans la limite légale de 7 500 euros), après la survenance du sinistre ? Ou faut-il au contraire dès à présent insérer dans les polices une clause fixant à tel ou tel pourcentage du montant de l’indemnité due à la victime (toujours dans la limite de 7 500 euros) la participation qui pourra être réclamée à l’assuré dans l’éventualité d’un sinistre survenu dans les circonstances visées à l’alinéa 2 de l’article L. 121-2 du Code des assurances ? Il appartiendra aux juges de trancher cette question. Cela étant, l’objectif de la loi étant de lutter contre la carence des parents, l’insertion d’une clause « de participation » paraît la solution la plus opportune. En effet, informer les parents que leur responsabilité civile ne sera plus intégralement couverte en cas de dommages causés par leurs enfants mineurs dans des circonstances faisant apparaître leur grave défaillance est de nature – il faut l’espérer – à les inciter à mieux éduquer et surveiller ceux-ci.

Il convient toutefois de souligner que la sanction (civile) des parents n’est pas impérative (alors même que les circonstances du sinistre l’autorisent). L’alinéa 2, nouveau, de l’article L. 121-2 du Code des assurances énonce en effet que « l’assureur peut exiger […] le versement d’une participation », ce qui signifie qu’il n’a pas l’obligation de le faire.
Cela étant, afin que la disposition nouvelle ne reste pas lettre morte, les assureurs se voient interdire une renonciation anticipée à se prévaloir du droit de réclamer une participation.
L’alinéa 3, nouveau, de l’article L. 121-2 du Code des assurances prévoit en effet, très clairement cette fois, que « toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa [de ce même article] est réputée non écrite ».
Ces nouvelles dispositions, tant pénales que civiles, réussiront-elles à endiguer la délinquance des mineurs ? L’avenir le dira…
Maud Asselain